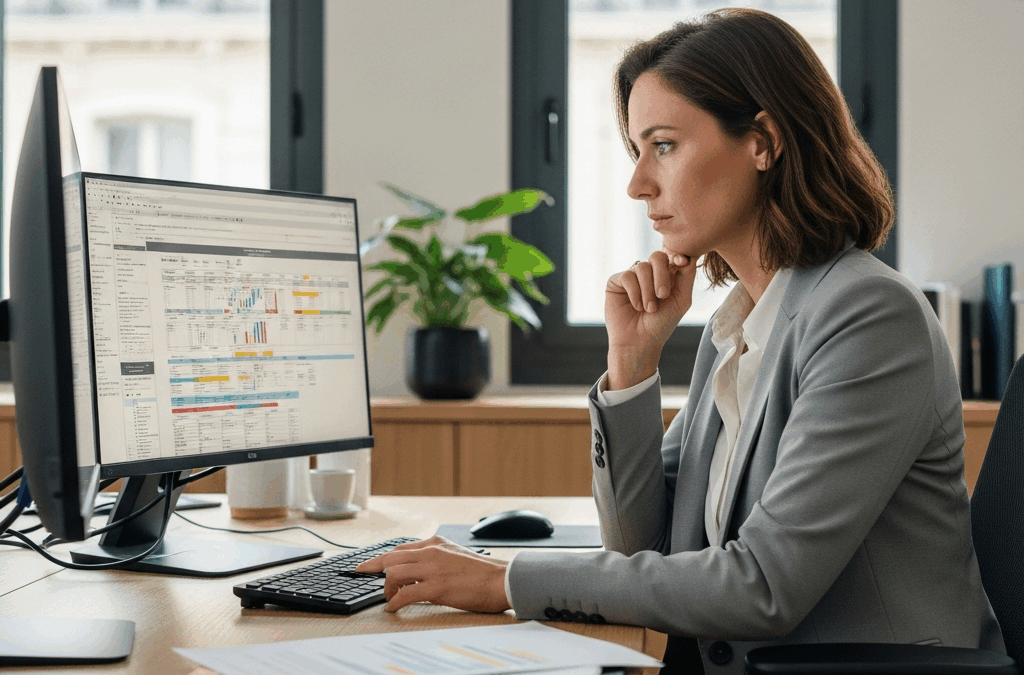La suspension du contrat de travail, qu’elle soit due à un arrêt maladie, un congé maternité ou un accident, représente une phase complexe pour l’employeur. Au-delà des obligations de maintien de certains droits pour le salarié, cette interruption temporaire soulève des questions juridiques précises quant à son impact sur des échéances aussi décisives que la période d’essai ou le préavis. Une gestion approximative de ces situations peut fragiliser la rupture du contrat et exposer l’entreprise à des contentieux. Maîtriser les règles applicables est donc essentiel pour sécuriser vos procédures et anticiper les risques. Face à la complexité de ces mécanismes, l’assistance d’un avocat expert en droit du travail (consultez notre page de présentation) est souvent indispensable pour garantir la conformité de vos décisions et éviter un futur litige.
Principes généraux de la suspension du contrat de travail
Avant d’analyser ses conséquences sur le préavis et la période d’essai, il est nécessaire de bien poser la définition et le cadre juridique de la suspension du contrat de travail.
Définition et portée de la suspension du contrat
La suspension du contrat de travail est une situation juridique qui interrompt temporairement les principales obligations des parties : le salarié n’exécute plus sa prestation de travail et l’employeur n’est plus obligé de verser la rémunération correspondante, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires. Cependant, le contrat de travail n’est pas rompu. Le lien contractuel subsiste, ce qui signifie que le salarié continue de faire partie des effectifs de l’entreprise. La suspension peut être déclenchée par de nombreux événements, dont le congé maternité, l’un des cas les plus courants (voir notre page guide) de suspension protégeant la salariée. Le principal objectif de ce mécanisme est de préserver la stabilité de la relation de travail et de l’emploi en permettant une reprise automatique lorsque l’événement suspensif a disparu. La volonté de l’employeur et du collaborateur de bien gérer cette phase est essentielle.
Caractères de la suspension licite : légitimité et temporalité
Pour être qualifiée de suspension et non d’absence injustifiée, l’inexécution du contrat doit répondre à deux critères fondamentaux. Premièrement, elle doit être légitime, c’est-à-dire fondée sur une cause reconnue par la loi (incapacité médicale, accident du travail, grève), une disposition conventionnelle, ou le contrat de travail lui-même. Une absence non autorisée et non justifiée par un motif légal ne constitue pas une suspension mais une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire, voire une mise à pied. Deuxièmement, la suspension est par nature temporaire. Elle constitue une phase intermédiaire avant la reprise de la relation de travail. Si l’empêchement devient définitif (par exemple en cas de force majeure), la logique de suspension n’a plus lieu d’être et la question de la rupture du contrat peut alors se poser.
Impact de la suspension sur le délai de préavis
La survenance d’un événement suspensif pendant la durée du préavis, qu’elle fasse suite à une démission ou un licenciement, obéit à des règles précises qu’il est impératif pour l’employeur de connaître afin de ne commettre aucun impair.
Le principe du délai préfix et ses implications
En droit du travail, le préavis est qualifié de délai « préfix ». Cela signifie qu’il ne peut être ni suspendu, ni interrompu. Une fois la notification de la rupture du contrat effectuée, le décompte des jours commence et ne s’arrête pas, même si un événement imprévu survient. Ainsi, un arrêt de travail pour une cause non professionnelle, une grève ou une période de chômage partiel (activité partielle) survenant pendant le préavis n’a pas pour effet de le prolonger. La date de fin du contrat reste donc inchangée. Le salarié qui se trouve dans l’impossibilité d’exécuter son préavis en raison de son état de santé perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale et, le cas échéant, le complément de l’employeur, mais il n’a pas à effectuer les jours de préavis non exécutés ni à verser une indemnité compensatrice.
Atténuations du principe : accident du travail et maladie professionnelle
Le principe du délai préfix connaît une exception majeure en cas de suspension provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle. La Cour de cassation, s’appuyant sur les articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du Code du travail, a jugé que la survenance d’un tel événement au cours du préavis entraîne sa suspension. Le préavis est interrompu pendant toute la durée de l’arrêt de travail et ne reprendra son cours qu’au retour du salarié dans l’entreprise. La date de fin de contrat est donc reportée d’une durée équivalente à celle de l’arrêt. Cette solution, plus protectrice pour le salarié, se justifie par le fait que l’accident ou l’affection trouve son origine dans l’exécution du travail pour l’entreprise. En revanche, cette jurisprudence ne s’applique pas à l’accident de trajet, qui n’est pas assimilé à un accident du travail pour cette règle spécifique.
Atténuations du principe : congés payés et autres absences
La prise de congés payés peut également reporter le terme du préavis, mais uniquement sous certaines conditions. Si les dates de congés payés ont été validées par l’employeur avant la notification du préavis de licenciement ou de la démission, le préavis est suspendu pendant la durée des congés. Il ne commencera à courir, ou ne reprendra son cours, qu’au retour du salarié. À l’inverse, si les congés n’étaient pas fixés, l’employeur ne peut pas imposer au salarié de les prendre pendant son préavis. Les parties peuvent toutefois convenir d’un commun accord que le salarié prendra ses congés pendant cette période ; dans ce cas, le préavis n’est pas suspendu. De plus, la loi du 22 avril 2024 (voir notre page d’actualité juridique) a mis le droit français en conformité avec le droit européen en prévoyant un droit au report des congés payés non pris du fait d’un arrêt de travail, quelle que soit son origine, sur une période de 15 mois.
Cumul des indemnités : spécificités en cas de suspension du préavis
La question du cumul des indemnités se pose différemment selon la cause de la suspension. Si un salarié bénéficie d’une dispense de préavis par la volonté de l’employeur et tombe malade, il cumule l’indemnité compensatrice de préavis versée par l’employeur et les indemnités journalières de la sécurité sociale. En revanche, s’il n’est pas dispensé et que son arrêt de travail pour raison de santé non professionnelle l’empêche d’exécuter le préavis, il ne perçoit que les indemnités maladie (sécurité sociale et complément employeur). Le droit à une indemnité compensatrice de préavis n’est pas ouvert pour les jours non travaillés. Le cas de l’accident du travail est différent : le préavis étant suspendu, le salarié perçoit ses indemnités journalières spécifiques, puis exécute le reste de son préavis à son retour, période pendant laquelle son salaire sera normalement versé.
Impact de la suspension sur la période d’essai
La période d’essai a pour but de permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié. Toute interruption du travail perturbe cette évaluation et entraîne des conséquences juridiques spécifiques, ce qui en fait un point de vigilance majeur pour l’entreprise.
Prorogation de la période d’essai : causes et modalités de calcul
Contrairement au préavis, la suspension de son contrat a pour effet de prolonger la période d’essai. La jurisprudence est constante sur ce point : la période d’essai est prolongée d’une durée égale à celle de la suspension. La finalité de l’essai, qui est une phase de travail effectif, justifie cette prorogation. Les causes de suspension qui entraînent cette prolongation sont nombreuses : arrêt de travail pour incapacité médicale ou accident (professionnel ou non), congés payés, jours de RTT, congé parental, congé de paternité, exercice d’un mandat, congé sans solde ou encore service national. Le calcul de la prolongation est strict : il correspond à la durée calendaire exacte de l’absence. Si un salarié est absent 10 jours calendaires, sa période d’essai est prolongée de 10 jours calendaires, peu importe le nombre de jours ouvrables ou ouvrés inclus dans cette phase.
Distinction maladie professionnelle vs. non-professionnelle sur la période d’essai
Si toute affection médicale prolonge la période d’essai, la distinction entre son origine professionnelle et non professionnelle redevient capitale en matière de rupture. La suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle déclenche une protection spéciale. L’employeur ne peut rompre la période d’essai pendant l’arrêt de travail, sauf en cas de faute grave ou lourde du salarié ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident. Une rupture pour « essai non concluant » serait jugée nulle, bien qu’une rupture conventionnelle puisse parfois être envisagée sous conditions strictes. En cas de problème de santé non professionnel, la protection est moindre. L’employeur peut rompre l’essai pendant l’arrêt, mais il doit être vigilant : la rupture ne doit jamais être motivée par l’état de santé du salarié, sous peine d’être jugée discriminatoire et donc nulle.
Mises à jour législatives et directives européennes sur la durée maximale de la période d’essai
Le cadre de la période d’essai a récemment évolué pour s’aligner sur le droit européen. La directive (UE) 2019/1152 a posé le principe d’une durée d’essai « raisonnable », ne devant pas excéder six mois. En conséquence, la loi française a été modifiée en 2023. Depuis le 9 septembre 2023, les durées maximales légales de la période d’essai, renouvellement inclus (4 mois pour les ouvriers/employés, 6 mois pour les techniciens/agents de maîtrise, 8 mois pour les cadres), ne peuvent plus être dépassées par des accords de branche, même s’ils ont été conclus avant la loi de 2008 qui le permettait. Pour les employeurs, cela signifie une vigilance accrue sur la durée stipulée dans les contrats et les conventions collectives applicables pour éviter les requalifications.
Rupture de la période d’essai pendant la suspension : cas spécifiques
La rupture de l’essai pendant une suspension est un terrain miné. Si un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à l’issue d’un arrêt pour accident du travail survenu pendant l’essai, l’employeur ne peut pas simplement rompre le contrat. Il est tenu par une obligation de reclassement, même à ce stade précoce de la relation de travail. Ce n’est que s’il démontre l’impossibilité de reclasser le salarié qu’il pourra procéder à la rupture, qui prendra alors la forme d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, avec les protections afférentes. Rompre l’essai sans recherche de reclassement serait sanctionné par les juges, le salarié pouvant contester la décision devant le conseil de prud’hommes.
Calculs précis et gestion des suspensions multiples
La gestion administrative de la période d’essai peut vite devenir complexe lorsque plusieurs suspensions de courte durée s’enchaînent, rendant le calcul de la date de fin d’essai délicat.
Méthodes de calcul pour jours calendaires, ouvrables et travaillés
La jurisprudence a clarifié la méthode de calcul de la prolongation de la période d’essai : elle se fait en jours calendaires. C’est-à-dire que tous les jours de la semaine sont comptabilisés, du premier au dernier jour d’absence, incluant les week-ends et jours fériés. Par exemple, un salarié en arrêt du jeudi 1er au mardi 6 d’un mois (6 jours calendaires), verra sa période d’essai prolongée de 6 jours, même s’il n’aurait dû travailler que 3 ou 4 jours sur cette période. La prise en compte ne se fait ni en jours ouvrables (tous les jours sauf le repos hebdomadaire et les jours fériés), ni en jours travaillés. Cette règle a le mérite de la simplicité mais impose une grande rigueur dans le suivi des dates.
Gestion des suspensions fractionnées et leur impact cumulé
En cas de suspensions multiples et fractionnées (par exemple, plusieurs arrêts de travail de quelques jours, un congé pour enfant malade, etc.), le principe reste le même. L’employeur doit additionner la durée calendaire de chaque période de suspension. La date de fin de la période d’essai initiale est alors reportée d’un nombre de jours égal au total de ces absences. La complexité naît du suivi méticuleux de chaque absence. Un tableur de suivi précis est souvent nécessaire pour éviter toute erreur qui pourrait conduire à rompre le contrat après l’échéance réelle de l’essai, transformant ainsi la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La situation se complique encore lorsque surviennent des conflits de causes ; une vigilance particulière est requise en cas de gestion des suspensions multiples et simultanées (voir notre page sur ce litige complexe), comme un arrêt de travail pendant une grève.
Conséquences juridiques et prévention des abus
La liberté de rupture de la période d’essai n’est pas absolue. L’employeur doit rester conscient des limites posées par la jurisprudence pour ne pas voir une rupture requalifiée en acte abusif ou discriminatoire.
Rupture abusive de la période d’essai : ‘légèreté blâmable’ et ‘intention de nuire’
Une rupture est considérée comme abusive si elle ne se fonde pas sur l’évaluation des compétences du salarié. La jurisprudence sanctionne l’employeur qui agit avec une « volonté de nuire » ou une « légèreté blâmable ». L’intention de nuire est rare et difficile à prouver. La légèreté blâmable est plus fréquente. Elle peut être caractérisée par une rupture intervenant très peu de temps après l’embauche, sans laisser au salarié le temps de faire ses preuves. De même, rompre l’essai pour un motif économique (difficultés économiques, suppression de poste) constitue un détournement de la finalité de l’essai et est donc abusif. La sanction est l’octroi de dommages-intérêts au salarié, dont le montant souverainement apprécié par les juges clôt le litige.
Obligations de l’employeur et droits du salarié en cas de suspension du contrat
Même lorsque le contrat est suspendu, les obligations secondaires subsistent. Le salarié reste tenu à une obligation de loyauté et de non-concurrence. De son côté, l’employeur conserve son pouvoir de direction et, dans une certaine mesure, son pouvoir disciplinaire pour des faits étrangers à la suspension et qui constitueraient un manquement à l’obligation de loyauté. Même durant une suspension, le lien de subordination subsiste, ce qui encadre strictement les obligations de l’employeur et les droits du salarié (notre page sur le sujet), y compris les limites de l’exercice du pouvoir disciplinaire. Une procédure rigoureusement menée, y compris pendant cette phase, protège l’entreprise tout en garantissant le respect scrupuleux des droits du salarié, ce qui constitue le meilleur rempart contre une contestation future.
Merci de votre lecture. La gestion de l’impact d’une suspension de contrat sur le préavis ou la période d’essai exige une connaissance pointue des règles légales et de la jurisprudence. Chaque situation est unique et une erreur de calcul ou d’appréciation peut avoir des conséquences financières et juridiques importantes. Notre cabinet est à votre disposition pour analyser votre situation et vous conseiller sur la stratégie la plus sûre à adopter.
Sources
- Code du travail : articles L. 1221-19 à L. 1221-26 (Période d’essai)
- Code du travail : articles L. 1234-1 et suivants (Préavis)
- Code du travail : articles L. 1226-7 et L. 1226-9 (Accident du travail et maladie professionnelle)
- Code du travail : article L. 1132-1 (Principe de non-discrimination)
- Directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles
- Jurisprudence constante de la Cour de cassation (Chambre sociale)